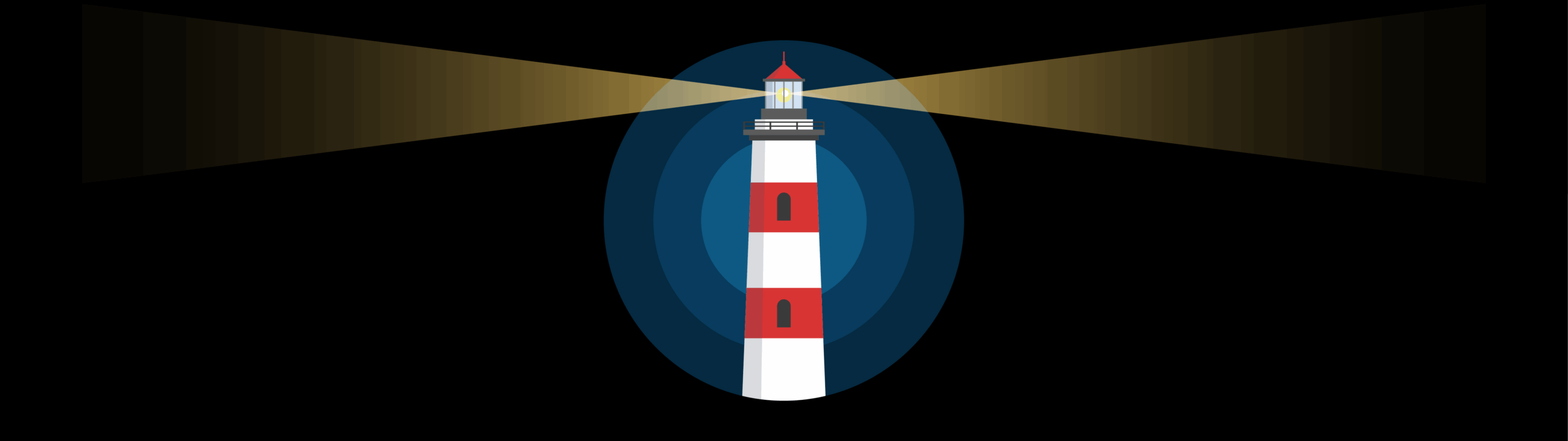Liberté académique
Parce qu’on ne peut ni chercher, ni transmettre, ni débattre librement
lorsque la peur dicte les limites du savoir.
Table des matières
Pourquoi la liberté académique est essentielle
La liberté académique est au cœur de la mission universitaire. Elle permet aux professeures et aux professeurs — ainsi qu’à toutes les personnes qui contribuent à la mission universitaire — d’enseigner, de chercher, de débattre et de critiquer sans contrainte doctrinale, idéologique ou politique. Concrètement, elle garantit que les connaissances peuvent être transmises, discutées et transformées dans une quête rigoureuse de la vérité, sans peur de représailles ou de censure.
Mais la liberté académique n’est pas un privilège individuel. C’est une nécessité collective. Elle assure que l’université, comme bien commun, puisse jouer pleinement son rôle dans la société. C’est grâce à elle que les débats difficiles peuvent avoir lieu, que les découvertes dérangeantes peuvent être publiées et que la critique des pouvoirs établis peut éclairer le public.
Dans les démocraties modernes, la liberté académique va de pair avec la vitalité de la vie collective. Là où elle est menacée, c’est non seulement l’indépendance des chercheur·euses qui est compromise, mais aussi la capacité de la société à progresser, à innover et à défendre le bien commun. La protéger, c’est protéger notre droit collectif à un savoir libre, diversifié et utile à toutes et tous.
La liberté académique va de pair avec la vitalité de la vie collective. Là où elle est menacée, c’est non seulement l’indépendance des chercheur·euses qui est compromise, mais aussi la capacité de la société à progresser, à innover et à défendre le bien commun.
Rallumer le phare

Une liberté menacée ici comme ailleurs
La liberté académique n’est jamais acquise. Elle se gagne — et se préserve — à travers des luttes difficiles, toujours à refaire. Partout dans le monde, elle se trouve d’ailleurs fragilisée par des pressions politiques, économiques et idéologiques. Dans plusieurs pays non démocratiques, des chercheur·euses sont arrêté·es, emprisonné·es, voire assassiné·es pour avoir abordé des sujets jugés dérangeants. Dans les démocraties dites libérales, les attaques prennent une autre forme : campagnes de dénigrement, menaces de censure, ingérences politiques ou pressions financières qui poussent à l’autocensure et affaiblissent l’indépendance des institutions. Les sciences humaines, sociales et de l’environnement sont particulièrement ciblées, car elles mettent souvent au jour des enjeux qui dérangent des pouvoirs établis.
Le Québec n’échappe pas à ces tensions. Bien que la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire reconnaisse désormais ce droit, son exercice demeure fragile à plusieurs égards. Des ingérences politiques au sein d’institutions d’enseignement supérieur ont assombri les dernières années. On invoque encore le devoir de loyauté, inscrit dans le droit du travail, pour limiter la critique des professeur·es envers leur propre université, créant un climat d’incertitude face à ce qui peut ou non être dit. Également, certaines controverses publiques ont révélé la tentation d’invoquer la civilité ou l’image institutionnelle pour restreindre la parole critique ou celle qui dérange. Résultat : un risque réel d’autocensure qui mine la capacité des universités de remplir leur mission fondamentale.
La liberté académique est donc à défendre partout et toujours. Car dès qu’elle recule, ce sont la recherche de la vérité, l’innovation et la démocratie elle-même qui reculent à leur tour.
Pourquoi la liberté académique nous concerne-t-elle toutes et tous ?
La liberté académique n’est pas un enjeu réservé aux professeures et aux professeurs : elle concerne l’ensemble de la société. Lorsqu’elle est affaiblie, ce sont les connaissances disponibles pour éclairer nos choix collectifs qui s’appauvrissent. Sans chercheurs et chercheuses libres, il y a moins d’exploration, moins d’innovation et moins de débats.
Le constat mondial est préoccupant. Selon l’Academic Freedom Index, 34 pays ont vu leur liberté académique décliner au cours de la dernière décennie, y compris des démocraties comme la Finlande, le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans plusieurs États, des gouvernements populistes ou autoritaires cherchent à contrôler les campus, à censurer certains domaines de recherche — comme les études de genre ou celles sur le climat — et à sanctionner les voix critiques. Or, l’université n’a pas pour mission de plaire : elle a pour mission de chercher et dire le vrai, de faire avancer le savoir, même quand cela dérange.
C’est pourquoi défendre la liberté académique, c’est défendre un droit collectif : celui d’accéder à des savoirs critiques, diversifiés et indépendants, capables de nourrir les choix démocratiques, d’anticiper les crises et d’imaginer des solutions nouvelles pour l’avenir.
L’université n’a pas pour mission de plaire : elle a pour mission de chercher et dire le vrai, de faire avancer le savoir, même quand cela dérange.
Rallumer le phare
Nos propositions pour rallumer le phare de la liberté académique
La liberté académique ne se défend pas seulement en paroles : elle exige des mesures concrètes. Pour qu’elle soit pleinement exercée, protégée et comprise, il est urgent de :
- Garantir l’autonomie institutionnelle et la collégialité comme conditions nécessaires au plein exercice de la liberté académique, à l’abri des ingérences politiques et des pressions externes.
- Former les membres des comités institutionnels sur la liberté académique, de manière qu’ils puissent réaliser au mieux leur mission de protection et de promotion de la liberté académique au sein des universités québécoises.
- Assurer et étendre des protections légales et institutionnelles contre les représailles, afin que toutes les personnes chargées d’enseignement et de recherche — y compris en situation de précarité — puissent contribuer pleinement à la mission universitaire.
- Former et sensibiliser la société civile à son importance, car défendre la liberté académique, c’est défendre le droit de toutes et tous à un savoir critique, indépendant et éclairant pour l’avenir.

Pour aller plus loin
- Signez la pétition déposée à l’Assemblée nationale, « Restauration et protection de la mission universitaire au Québec ».
- Partagez nos infographies « Quand la peur s’installe, le savoir recule » et « Le droit d’explorer toutes les pistes » sur vos réseaux sociaux.
Voyez Facultés en alerte, une série coproduite avec Savoir média qui éclaire l’un des fondements de notre démocratie, mais dont l’importance reste méconnue. Cette série présente des situations réelles qui la menacent et des façons de la protéger.
Les travaux du Comité permanent sur la liberté académique
Le Comité permanent de la liberté académique (COPLA) de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) documente, protège et fait la promotion de la liberté académique, et examine les plaintes de ses membres à ce sujet. Depuis 2022, le COPLA procède sans relâche à la publication d’avis et de mémoires qui permettent de mieux comprendre ce pilier fondamental de la mission universitaire.
- La collégialité et la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire
Octobre 2025. L’Avis n° 8 du Comité permanent sur la liberté académique. - La liberté académique et les règles et pratiques imposant la précarité aux personnes contribuant à la mission universitaire
Février 2025. L’Avis n° 7 du Comité permanent sur la liberté académique. - Éthique de la recherche et liberté académique
Février 2024. L’Avis n° 6 du Comité permanent sur la liberté académique. - Liberté académique et liberté d’expression dans les institutions éducatives : une contribution de la FQPPU
Janvier 2024. Note du comité permanent sur la liberté académique à l’attention de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l’éducation, Madame Farida Shaheed. - Le devoir de loyauté à l’aune de la liberté académique – Atelier-conférence
Octobre 2023. Un atelier-conférence pour mieux comprendre l’Avis n° 5 de la Commission permanente sur la liberté académique. - Le devoir de loyauté à l’aune de la liberté académique
Octobre 2023. L’Avis n° 5 de la Commission permanente sur la liberté académique. - Examen de l’impact de certaines dispositions du projet de loi 23
Septembre 2023. L’Avis n° 4 de la Commission permanente sur la liberté académique. - Les effets de la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire sur les conventions collectives
Novembre 2022. L’Avis n° 3 de la Commission permanente sur la liberté académique. - Les contours de la liberté académique selon la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire
Octobre 2022. L’Avis n° 2 de la Commission permanente sur la liberté académique. - Mémoire de la FQPPU sur le projet de loi n° 32 Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire
Mai 2022. Mémoire de la Commission permanente sur la liberté académique déposé dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 32. - Analyse sommaire du rapport de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire
Février 2022. L’Avis n° 1 de la Commission permanente sur la liberté académique.
Engageons-nous collectivement à défendre la mission d’intérêt public de nos universités
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles de notre campagne.