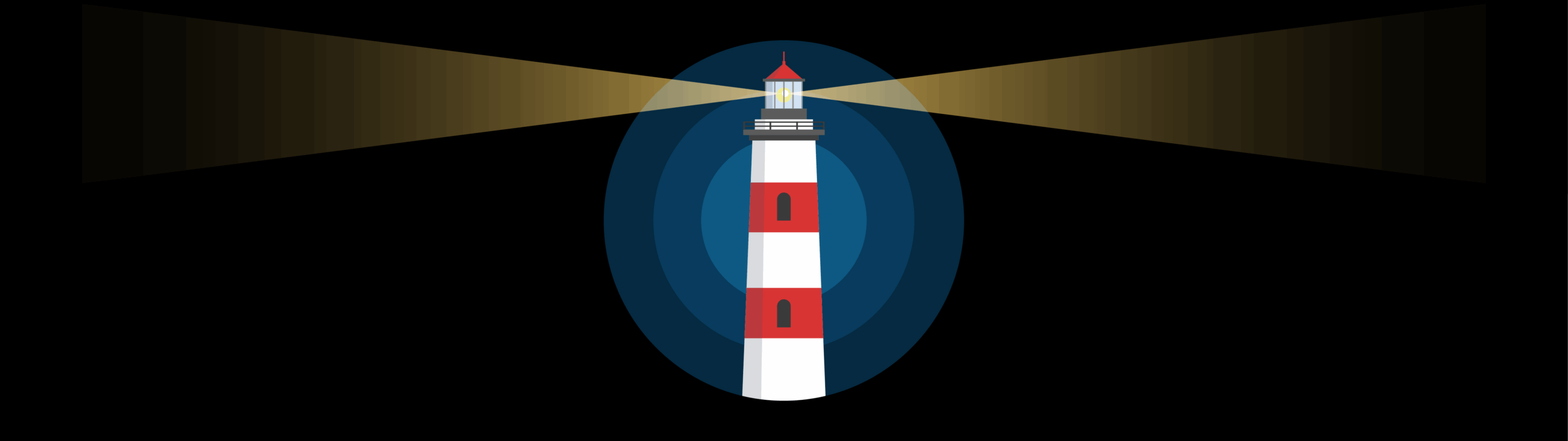Autonomie institutionnelle
Parce qu’une université soumise à des dictats qui lui sont étrangers
ne peut ni déranger, ni éclairer, ni transformer le monde.
Table des matières
Pourquoi l’autonomie des universités est essentielle
Une université ne fonctionne véritablement que lorsqu’elle peut librement choisir ses orientations. Libre de définir ses programmes, ses priorités et ses valeurs ; libre de définir ses orientations de recherche dans une quête rigoureuse de la vérité, non selon la conjoncture ; libre de répondre à sa mission d’intérêt public plutôt qu’à des injonctions politiques, idéologiques ou économiques.
C’est ce qu’on appelle l’autonomie institutionnelle : la capacité d’une université à se gouverner elle-même, à l’abri des pressions externes qui menacent son rôle social et son intégrité intellectuelle.
L’autonomie institutionnelle permet à chaque établissement de prendre des décisions éclairées par le dialogue et la collégialité. Elle lui permet également de définir ses programmes, de nommer son personnel et ses administrateurs, d’adopter ses priorités de recherche et de gérer ses ressources en toute indépendance. Normalement, c’est à la collectivité qu’une université autonome doit rendre des comptes, plutôt qu’au gouvernement.
L’autonomie institutionnelle n’est pas un privilège. C’est une condition essentielle à la contribution des universités au bien commun, car une université assujettie cesse d’être un lieu de savoir libre. Elle devient un instrument de pouvoir.
L’autonomie institutionnelle n’est donc pas un concept abstrait. Elle représente le premier rempart protégeant la liberté de penser, d’enseigner et de débattre.
Une protection fragilisée
Au fil des décennies, l’autonomie des universités québécoises — reconnue depuis la Commission Parent comme une garantie essentielle de leur mission, réitérée par l’UNESCO dans sa Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur — s’est progressivement érodée.
Les mécanismes de contrôle et de reddition de comptes se sont multipliés, réduisant la marge de manœuvre des établissements. Cette tendance se manifeste partout au Canada : les gouvernements cherchent de plus en plus à aligner les universités sur leurs priorités politiques ou économiques, au détriment de la liberté des communautés universitaires de choisir leurs orientations.
Au Québec, ce glissement prend plusieurs formes préoccupantes, notamment un alourdissement bureaucratique et une logique managériale remplaçant peu à peu la gouvernance collégiale.
L’érosion de l’autonomie institutionnelle entraîne des répercussions concrètes : une uniformisation des savoirs, une réduction de la recherche libre et une fragilisation de la mission d’intérêt public des universités.
Plus que jamais, les universités se trouvent tiraillées entre le rôle qu’elles doivent jouer pour le bien commun et les impératifs politiques, idéologiques et économiques du moment. Cela nous concerne donc toutes et tous — pas juste les professeures et les professeurs d’université ! L’autonomie institutionnelle protège notre droit collectif à un savoir libre et rigoureux. C’est elle qui garantit que les découvertes, les débats et les innovations naissent d’une recherche honnête et rigoureuse de la vérité, et non de la volonté de plaire aux pouvoirs en place.
Nos propositions pour rallumer le phare
Pour restaurer la confiance et garantir une autonomie institutionnelle réelle, les universités doivent pouvoir servir l’intérêt public sans craindre les pressions du pouvoir, de l’économie ou du moment. Cela exige une action politique et institutionnelle claire et ferme.
- Reconnaître, dans toute décision politique concernant les universités, que l’autonomie institutionnelle constitue l’une des conditions essentielles à l’accomplissement de leur mission, comme le prévoient les principes de la Loi.
- Renforcer et protéger la gouvernance collégiale contre les ingérences politiques, économiques et idéologiques, afin que les décisions soient prises dans l’intérêt de la communauté universitaire et de la société.
- Réduire le fardeau des mécanismes de contrôle et de la reddition de comptes excessive pour alléger l’alourdissement bureaucratique.
- Garantir un financement public stable et prévisible, car aucune autonomie n’est possible sans un minimum de sécurité financière.
- Améliorer la transparence et les processus de diffusion des savoirs, de manière à ce que ce soit à la société que les universités rendent des comptes, et non aux pouvoirs en place.