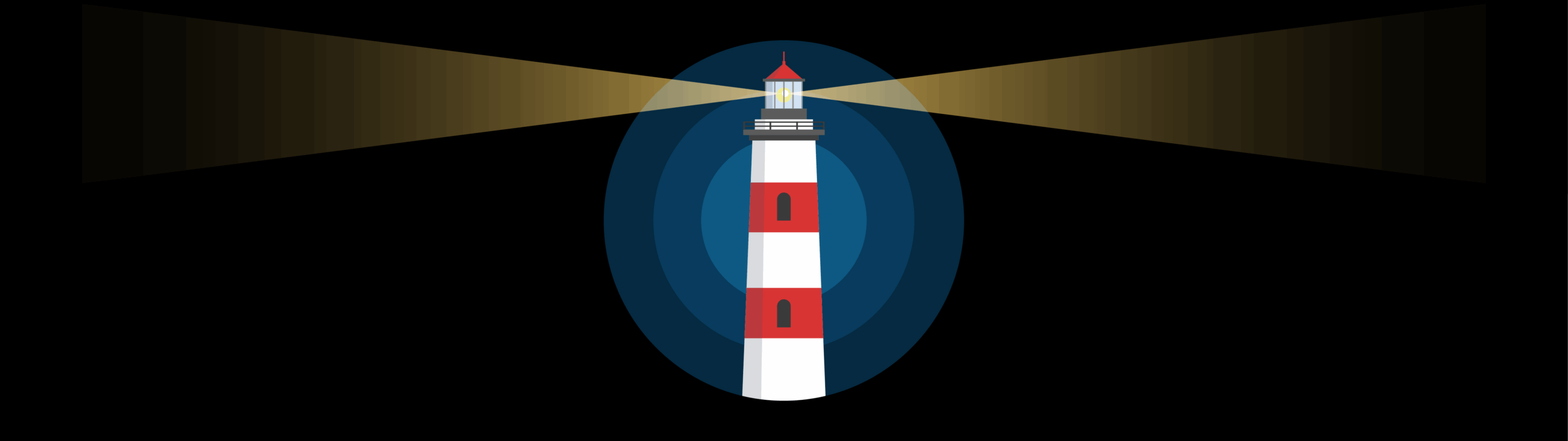Collégialité universitaire
Parce qu’on ne peut défendre la mission d’intérêt public des universités
si l’on met de côté ses principaux acteurs.
Table des matières
Qu’est-ce que la collégialité universitaire ?
La collégialité universitaire, bien que méconnue, est véritablement au cœur de l’université. Elle désigne un mode de gouvernance démocratique et partagé, où la communauté universitaire et, plus spécifiquement, le corps formé de celles et ceux qui font la recherche et transmettent les connaissances, participe collectivement aux décisions qui façonnent l’enseignement, la recherche et la vie institutionnelle. Elle s’oppose à la gouvernance de la majorité des entreprises, où ce sont des dirigeant·es, hiérarchiquement au sommet de l’organisation, qui définissent les orientations et prennent les décisions.
L’un des piliers essentiels de la mission universitaire, la collégialité universitaire assure que l’université demeure au service de l’intérêt public, et non soumise aux pressions politiques, idéologiques ou financières.
Concrètement, elle garantit entre autres que :
- les programmes d’études sont définis par le corps professoral sur la base de débats démocratiques ;
- les décisions institutionnelles reposent sur une diversité de voix et de disciplines, plutôt que sur une vision imposée du haut ;
- l’université reste un lieu de délibération critique et d’innovation collective, à l’abri des logiques de marché.
Sans gouvernance collégiale, le pouvoir au sein de l’université risque d’être accaparé par une poignée de dirigeant·es, agissant comme des chefs d’entreprise, dictant la voie à suivre sur la base de leur vision particulière et se trouvant toujours à risque de céder aux pressions idéologiques, politiques et économiques.
Avec une gouvernance collégiale, l’université demeure un phare démocratique, capable d’éclairer la diversité des enjeux sociétaux par la pluralité des savoirs et la recherche du bien commun.
La collégialité universitaire assure que l’université demeure au service de l’intérêt public, et non soumise aux pressions politiques, idéologiques ou financières.
Rallumer le phare

Pourquoi la collégialité universitaire est cruciale
La collégialité universitaire n’est pas un luxe, mais une condition de survie pour l’université. Elle agit comme un garde-fou contre l’arbitraire et le dogmatisme, en empêchant que des intérêts privés imposent des choix guidés par des pressions économiques, politiques ou idéologiques.
La collégialité universitaire est aussi garante de la diversité des savoirs. Parce que nul ne peut prétendre détenir seul la vérité dans tous les domaines, les décisions se construisent à travers le dialogue et la confrontation d’idées.
Enfin, la collégialité fait de l’université un véritable espace démocratique, où les orientations en enseignement et en recherche reposent sur la participation active de la communauté.
Sans la collégialité, l’université s’appauvrit intellectuellement. Avec elle, elle demeure une force critique et créative au service du bien commun.
La collégialité universitaire est garante de la diversité des savoirs : parce que nul ne peut prétendre détenir seul la vérité dans tous les domaines, les décisions se construisent à travers le dialogue et la confrontation d’idées.
Rallumer le phare

La collégialité en péril
Aujourd’hui, ce pilier essentiel de la vie universitaire est fragilisé de toutes parts. Parmi les menaces principales, on compte :
- L’individualisme croissant, qui fragmente les solidarités et oppose les carrières individuelles à l’engagement collectif ;
- La surcharge de travail et l’isolement, qui laissent trop peu de temps pour la délibération ;
- La hiérarchisation et la bureaucratisation, qui réduisent la collégialité à des consultations sans portée réelle ;
- Les abus et manipulations, qui détournent les processus démocratiques au profit d’intérêts particuliers ;
- L’instrumentalisation des rouages institutionnels, qui limite la capacité d’agir des membres du corps professoral ;
- Le désintérêt des professeur·es pour les postes de gestion, découlant le plus souvent de la surcharge de travail et le sentiment d’être réduit à un rôle d’exécutant, qui affaiblit la représentativité et renforce la centralisation ;
- La prolifération de consultations « symboliques » et la perte de confiance, alimentée par des décisions prises sans réel dialogue.
Ces dynamiques constituent un sabotage silencieux. Elles transforment la gouvernance universitaire en exercice vertical et appauvrissent la mission même de l’université.

Protéger et refonder la collégialité
L’érosion de la collégialité universitaire n’est pas une fatalité. Elle peut et doit être restaurée. La FQPPU propose quatre leviers d’action concrets :
- Responsabilisation collective : réinvestir les comités, conseils et assemblées, oser questionner et engager le débat et exiger qu’on reconnaîsse l’expertise des communautés universitaires comme moteur des décisions clés ;
- Transparence et communication : rendre les processus décisionnels clairs, assurer qu’ils respectent les principes de fonctionnement démocratique, nourrir le dialogue et rétablir la confiance ;
- Autonomie institutionnelle et liberté académique : résister à la marchandisation du savoir et protéger l’université des ingérences externes ;
- Rôle des syndicats : agir comme contre-pouvoir démocratique, obtenir des structures de gouvernance plus équitables et mobiliser la communauté universitaire.
Restaurer la collégialité, c’est faire en sorte que l’enseignement, la recherche et la création restent au service du bien commun.
Pour aller plus loin
- Signez la pétition déposée à l’Assemblée nationale, « Restauration et protection de la mission universitaire au Québec ».
- Lisez notre article : « Collégialité universitaire : 5 faits essentiels à retenir », dans lequel l’on explique l’articulation entre la liberté académique et la collégialité universitaire.
- Lisez notre article : « Collégialité en péril ? 7 menaces à un pilier essentiel de l’université », dans lequel l’on explique les défis qui fragilisent la mise en œuvre de la collégialité dans nos universités.
Engageons-nous collectivement à défendre la mission d’intérêt public de nos universités
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles de notre campagne.