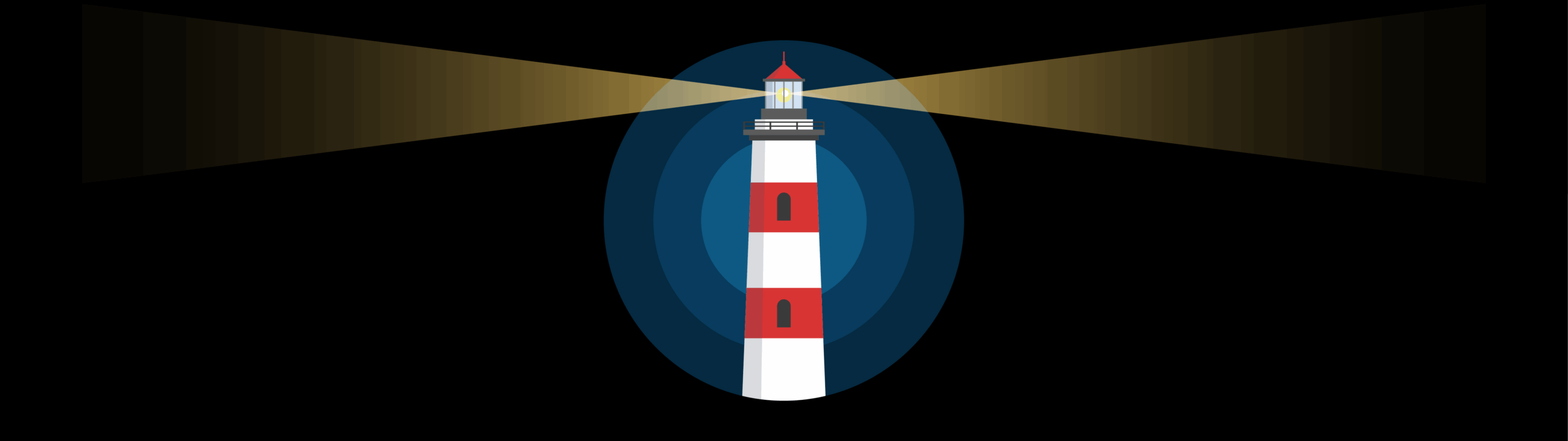Contre la marchandisation du savoir
Parce que ce qui nous éclaire et nous oriente ne devrait jamais être vendu au plus offrant.
Table des matières
Pourquoi la défense du savoir comme bien commun est essentielle
L’université n’est ni une entreprise ni une marque. Sa mission n’est pas de produire des profits, mais de cultiver la liberté intellectuelle, l’esprit critique et la capacité d’agir de manière éclairée dans un monde complexe. C’est un espace collectif de création, de transmission et de partage du savoir — un bien commun qui appartient à toute la société. C’est ce qui en fait un pilier de notre démocratie : un lieu où la vérité se cherche, se discute et se transmet librement, au bénéfice de toutes et tous.
Depuis de nombreuses décennies, cependant, une transformation profonde s’opère. Sous couvert de la recherche d’efficacité, la logique du marché s’invite dans le monde universitaire. Les étudiantes et étudiants deviennent des « clients », les professeures et professeurs des « producteurs », et les savoirs, des « produits » destinés à être vendus.
Ce glissement change la nature même de l’université. La recherche se trouve orientée par les intérêts des entreprises ; les programmes sont évalués selon leur rentabilité ; la compétition supplante la coopération ; la mission d’intérêt public des universités s’efface derrière des objectifs calqués sur ceux de l’entreprise privée : gestion de l’image corporative, volonté de performer dans les classements et quête de profit.
Le résultat ? Un appauvrissement intellectuel et social. Les disciplines jugées « non rentables » et la recherche fondamentale sont fragilisées. Les savoirs critiques perdent du terrain. La précarité s’installe chez les personnels universitaires. Et les universités s’éloignent de plus en plus de leur raison d’être : éclairer, émanciper, transformer.
Une dérive mondiale, visible ici
La marchandisation du savoir n’est pas un phénomène propre au Québec. Partout dans le monde, la logique du marché s’est insinuée dans les universités, transformant progressivement leur mission publique en carte de services présentée aux plus offrants.
Ce glissement s’exprime sous plusieurs formes : montée des partenariats commerciaux, dépendance accrue envers le financement privé, réduction du rôle des instances collégiales et alignement des priorités de recherche sur les besoins du marché.
Au Québec, les mêmes dynamiques s’installent. Une infiltration du langage et des méthodes de gestion entrepreneuriale — contrôle, rentabilité, performance — transforme la culture universitaire. On observe une coupure de plus en plus nette entre les fonctions de professeur·e et les rôles administratifs, ce qui a pour effet d’éloigner les dirigeant·es de la réalité de l’enseignement et de la recherche. Et les acteurs issus du monde des affaires sont de plus en plus nombreux sur les conseils d’administration des universités ou proches de ceux-ci, ce qui tend à les rapprocher de la culture propre aux entreprises privées.
Cette tendance mondiale a un prix :
- Une recherche de plus en plus orientée vers la rentabilité et les retombées économiques à court terme ;
- Une homogénéisation des savoirs, au détriment de la diversité intellectuelle ;
- Un ralentissement de la recherche sur des questions essentielles à l’avancement du savoir et au bien-être des populations, mais qui ne sont pas liées à des retombées économiques directes à court terme.
- Une perte d’autonomie institutionnelle, remplacée par une logique comptable ;
- Une précarisation du corps professoral et de la relève scientifique ;
- Et une érosion du rôle social de l’université comme lieu de développement de l’esprit critique et de débat libre.
L’université peut choisir une autre voie. Celle d’un savoir qui ne se vend pas, mais qui se partage. Celle d’une institution qui éclaire le monde plutôt qu’elle ne se conforme aux dictats du marché.
Nos propositions pour rallumer le phare
Restaurer la mission publique de l’université exige de rompre avec la logique marchande. Pour que l’université demeure un lieu de connaissance, d’émancipation et de débat, il faut de toute urgence :
- Réaffirmer le financement public comme condition essentielle de l’indépendance intellectuelle : un financement stable, prévisible et suffisant est la seule garantie que les universités servent l’intérêt général plutôt que des intérêts privés.
- Renforcer la collégialité et limiter l’influence des conseils dominés par les milieux d’affaires : la culture des universités doit rester universitaire, et ne pas être tirée vers celle de l’entreprise privée ou vers la quête de rentabilité.
- Garantir l’autonomie institutionnelle face aux pressions économiques : une université libre doit pouvoir choisir ses priorités, ses programmes et ses orientations sans subir les impératifs du marché.
- Protéger la liberté académique contre les contrats et partenariats qui orientent la recherche : la science doit impérativement rester au service du bien commun, et elle éclaire la société lorsqu’elle est libre, critique et indépendante.